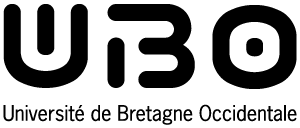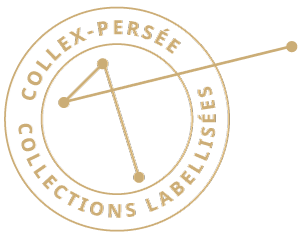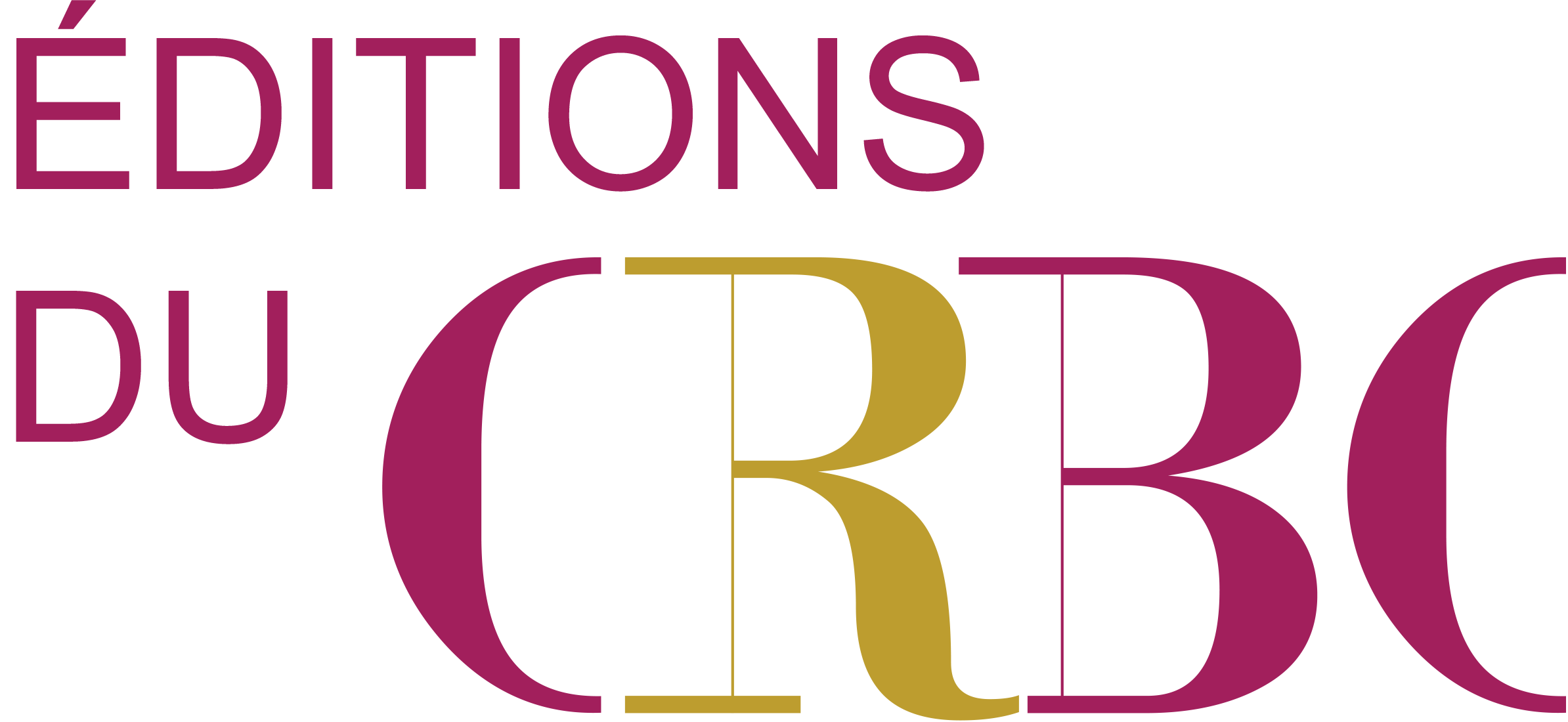Yvon Tranvouez
Professeur émérite d'histoire contemporaine et directeur de l'ouvrage Qu'est-ce qu'un laboratoire ? Le Centre de recherche bretonne et celtique (1969-2019)
Comment en êtes-vous arrivé à travailler sur cet objet ?
Par curiosité et aussi, sans doute, par insatisfaction. Le CRBC, qui est né en 1969, a donc aujourd’hui 56 ans, et il n’y a pas beaucoup de laboratoires de recherches en sciences humaines qui puissent se targuer d’une telle longévité. Comme dans beaucoup d’institutions, on y a célébré rituellement les dix ans, vingt ans, trente ans, quarante ans… À chaque fois, on se félicitait de tout ce qu’on avait réussi, et on avait assurément raison de le faire. Mais lorsqu’est venue la perspective du cinquantième anniversaire, je me suis dit, avec d’autres, qu’à côté des congratulations d’usage, expressions d’une mémoire heureuse, il serait intéressant d’esquisser une véritable histoire du CRBC. L’idée était de comprendre pour quelles raisons le laboratoire avait été créé, comment il s’était développé et quelles difficultés, externes ou internes, il avait affrontées au cours du temps. En d’autres termes, je pensais que nous devions, un jour ou l’autre, réfléchir, sans tabou ni complaisance, sur les origines et les devenir du CRBC, et ce d’autant plus que celui-ci avait toujours été, chez ceux qui s’intéressaient à ses travaux, l’objet d’appréciations contradictoires : modèle d’approche scientifique sur la matière bretonne et celtique pour les uns, dangereux instrument de patrimonialisation de la culture bretonne pour les autres. D’où cette sorte d’auto-analyse, menée en toute indépendance d’esprit par neuf chercheurs, de diverses générations et pas toujours d’accord entre eux. Je ne connais pas beaucoup d’équivalents en France.
Écrire en historien, qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
C’est d’abord exercer un métier, qui s’apprend et ne s’improvise pas. Et l’une des premières choses que l’on apprend, lorsque l’on s’initie à la discipline historique, c’est que la faute la plus grave, quand on étudie le passé, c’est l’anachronisme. Certes, ce sont les préoccupations d’aujourd’hui qui orientent spontanément notre interrogation sur hier. Raison de plus pour veiller à ce que nos lunettes actuelles ne nous amènent pas à nous faire une image a priori, et donc déformée, du passé. Pratiquer l’histoire, c’est avant tout montrer la différence des temps. Cette tâche s’impose d’autant plus à l’heure actuelle que notre société est saturée de mémoire victimaire et obsédée de morale rétrospective. Il est complètement incongru de reprocher à nos ancêtres des pratiques que nous jugeons aujourd’hui scandaleuses, alors qu’elles n’étaient pas perçues comme telles dans la société dans laquelle ils vivaient, parce que le contexte et les mentalités étaient autres. C’est bien pourquoi d’ailleurs, contrairement à ce que l’on répète paresseusement, l’histoire ne donne pas de leçons : elle rend sensible à la relativité des époques, elle n’enseigne que le bon usage du doute. L’historien a pour fonction de comprendre et de faire comprendre le passé, pas de le juger. Je trouve les repentances idiotes et inutiles. Et les lois mémorielles, qui définissent, en somme, une « vérité » officielle et obligatoire, me semblent absurdes et dangereuses.
Exercice d’admiration
Je remarque que, plus j’avance en âge, plus je privilégie, dans le choix de mes lectures, les historiens que j’admire. Et l’un des critères déterminants, c’est la qualité de leur style. Quand j’étais étudiant, la mode était à écrire terne pour faire scientifique : c’était sérieux mais souvent emmerdant. J’ai respiré le jour où je me suis mis à lire des historiens qui, tout en étant profonds, maniaient une plume ironique et provocatrice à la fois, comme Lucien Febvre, dont les Combats pour l’histoire ont été pour moi une révélation. Mais j’ai surtout été marqué par mon directeur de thèse, Émile Poulat (1920-2014), spécialiste de sociologie historique du catholicisme. Il écrivait superbement. Je lui dois quelques principes essentiels :
- aucun sujet, même le plus chaud et le plus sensible, n’est impossible à traiter : tout est affaire de doigté ;
- faire de l’histoire, c’est se poser un problème et s’équiper comme on peut pour le résoudre, mais sans jamais négliger le travail au long cours qui consiste, grâce à de vastes lectures, à se créer une culture érudite indéfiniment capitalisée ;
- sans négliger l’enquête orale, quand elle est encore possible, la priorité doit être donnée aux textes d’époque ;
- il faut se méfier du fétichisme des archives, qui conduit trop souvent à négliger la lecture attentive de la documentation imprimée. De lui, je viens de relire L’ère postchrétienne. Un monde sorti de Dieu (Flammarion, 1994) : un passionnant mélange d’autobiographie et d’analyse des mutations religieuses du XXe siècle.