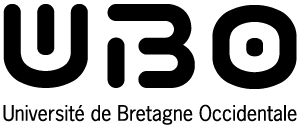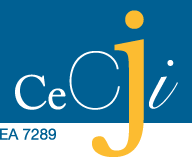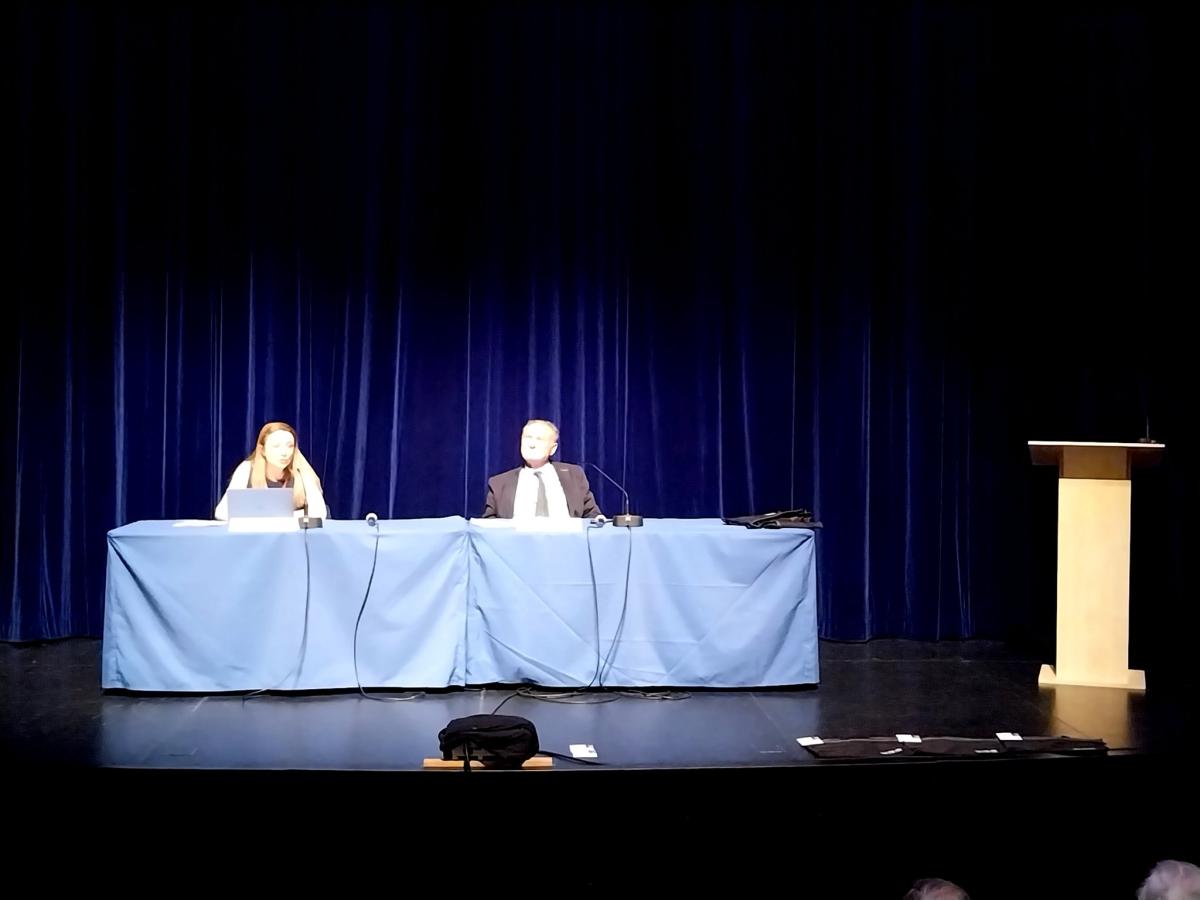
Sophie Guermès, conférence "Histoire d'une demeurée. Anthropologie, théologie, mystique", 30 juin 2023 (président de séance: Henri Le Bellec). Colloque organisé à l'occasion du bicentenaire d'Ernest Renan, à Tréguier (Théâtre de l'Arche) : Renan, Breton de Tréguier, entre terre et mer (30 juin-1er juillet 2023).
PROGRAMME
Vendredi 30 juin
10h00 Accueil des participants
10h10 Sophie Guermès, Introduction au colloque
Présidence Henri Le Bellec (Comité Renan)
10h30-11h15 Jean Balcou (UBO-CECJI-Comité Renan) 1802. Un concert pour un embryon ou la mort de Victor Hugo célébrée par Renan (lu par Jean Glasser)
Discussion
11h30-12h15 Sophie Guermès (UBO-CECJI-Comité Renan) Histoire d’une demeurée. Anthropologie, théologie, mystique
Discussion
Déjeuner
Présidence Yves Revault d’Allonnes (Comité Renan)
14h30-15h15 Henri Le Bellec (Comité Renan) Renan et le tropisme de la mer
Discussion
15h30-16h15 Sophie Gondolle (UBO-CECJI) Contes et légendes de Bretagne
Discussion et pause
Présidence Jean Glasser (Comité Renan)
16h30-17h00 Camille Raguenes (UBO-CECJI) Henriette Renan, éducatrice bretonne
Discussion
17h15-18h00 Sandrine Montreer (Comité Renan) De la maison natale au musée
18h30 Lecture de textes par Paul Barge
Samedi 1er juillet
Présidence Domenico Paone (Item-Cnrs)
10h00-11h00
André Stanguennec (Université de Nantes) Les apports de Victor Cousin et de Hegel dans la culture philosophique de Renan
Discussion
Présidence Brigitte Krulic (Université Paris-Ouest Nanterre)
11h15-12h00 Maya Boutaghou (University of Virginia) Questions et méthodes appliquées à Ernest Renan : Qu’est-ce qu’une nation ? (1882). De l’empire à la nation.
Discussion
12h15-13h00 Carole Reynaud-Paligot (Universités de Bourgogne et Panthéon-Sorbonne) Renan entre race et nation
Discussion
Déjeuner
Présidence : Valentino Petrucci (Università degli studi del Molise)
15h00-15h45 Émilie Piton-Foucault (Université Rennes II) Le « cas » Renan vu par Paul Bourget
Discussion
16h00-16h45 Domenico Paone (ITEM-CNRS) Entretien avec Sophie Guermès à propos de La fabrique des Sémites (Presses universitaires de France, 2023)
16h45-17h30 Tomasz Szymański (Université de Wrocław) Ernest Renan, Joachim de Flore (lu par Sophie Guermès)
Discussion et clôture du colloque
Spectacle théâtral : Création de la pièce « Une femme incomparable » par la troupe Cheap Cie
Avec le soutien de la DRAC Bretagne (Ministère de la Culture), de la Région Bretagne, du Conseil départemental des Côtes d'Armor, de la Communauté d'agglomération Lannion-Trégor, de la Ville de Tréguier, du Comité Renan et du CECJI (UBO).
Le bicentenaire d'Ernest Renan est inscrit aux Commémorations 2023 (France Mémoire).
***
Comité d’honneur
Jean Balcou
Comité scientifique
Jean Balcou (UBO-CECJI)
Sophie Guermès (UBO-CECJI)
Brigitte Krulic (U. Paris Nanterre)
Valentino Petrucci (U. Molise)
Comité d’organisation
Comité Renan
Certains textes sont publiés ci-dessous en accès libre, en complément du volume Ernest Renan. Une pensée complexe (à paraître aux éditions Peter Lang en 2024).