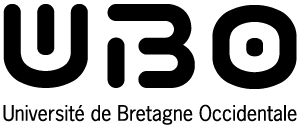Interview écrite sur le site de l'éditeur
Présentez-nous votre ouvrage
Il y a deux histoires, qui se croisent. D’abord, une femme dont le mari donne des conférences dans un pays lointain emmène ses enfants à Venise, pour qu’ils assistent à la fin du carnaval puis visitent la ville. Mais un événement imprévu se produit, en ces derniers jours de février 2020 : en raison d’une menace sanitaire, le carnaval est interrompu, et bientôt le monde entier est en suspens, confronté à une pandémie qui contraint les gouvernements à imposer un confinement. Avant de quitter Venise, la narratrice achète un livre intitulé Autour d’un puits, qui relate un épisode de la vie de Claudio Monteverdi, devenu prêtre le 16 avril 1632, pendant la semaine sainte, alors que la ville sortait d’une épidémie de peste qui avait duré seize mois. Peu à peu, ce qu’elle vit s’avère le reflet de ce qu’elle découvre en lisant la chronique vénitienne : l’ignorance des médecins, l’impuissance des dirigeants, les querelles scientifiques, les morts qu’on ne peut endiguer, les précautions sanitaires contradictoires et parfois dérisoires...
Le livre accorde une place importante à la musique et à la spiritualité. Pouvez-vous développer ce double aspect ?
Contrairement à mon héroïne, je n’ai pas attendu 2020 pour connaître Monteverdi. J’en ai eu la révélation en juillet 1998, en me rendant au festival d’Aix-en-Provence. J’avais réservé pour le Don Giovanni de Mozart mis en scène par Peter Brook, et comme on programmait aussi deux œuvres de Monteverdi j’ai choisi la première, l’Orfeo, plutôt pour me familiariser avec l’ancêtre de l’opéra que par attirance pour un compositeur dont je n’avais entendu, en disque, que le Lamento d’Ariane, dans une version qui ne m’avait absolument pas convaincue, celle de Michel Corboz, chef de renom mais qui n’était pas du tout monteverdien. Ma première rencontre avec Monteverdi avait donc été négative, comme ce fut presque toujours le cas avec ceux qui allaient être importants dans ma vie. Mais dans la nuit du Théâtre de l’Archevêché, sous la baguette de René Jacobs, avec la mise en mouvement imaginée par Trisha Brown, Orfeo fut un enchantement. Je n’eus qu’un regret : ne pas avoir réservé pour Le Couronnement de Poppée ; mais une seconde chance me fut donnée l’année suivante car le festival d’Aix le programma de nouveau, et ce fut un nouvel enchantement, cette fois-ci sous la baguette de Marc Minkowski. Et cette année-là, le hasard a voulu que je retourne à Venise.
Non seulement j’ai écouté et réécouté ses madrigaux, ses opéras (avec un sommet atteint par Gabriel Garrido dirigeant Orfeo, Le Couronnement de Poppée et Le Retour d’Ulysse dans sa patrie), sa musique sacrée (avec deux sommets, Les Vêpres de la Vierge dirigées par Jordi Savall et la Selva morale e spirituale par Garrido), mais j’ai lu aussi dans plusieurs langues ce qui avait été écrit sur Monteverdi. Au détour d’une phrase, sans s’y arrêter ni commenter cet acte, ses biographes, pourtant remarquables (je pense notamment à Leo Schrade et à Roger Tellart) mentionnaient qu’il était devenu prêtre à la fin de sa vie. Je l’ai remarqué sans y prêter vraiment attention. Il m’a donc fallu une vingtaine d’années pour que cela émerge, sorte de l’inconscient, du semi-oubli ou de l’indifférence. C’est pourquoi j’ai placé en épigraphe cette phrase de Wanda Półtawska, femme de science mais aussi de foi – une phrase qui peut aussi bien s’appliquer à Monteverdi qu’à moi-même : « La vie intérieure de l’homme a sa dynamique. Tout s’accomplit en lui en son temps, lentement. »
En 2020, le monde était confronté à une situation inédite, impensable, sauf qu’en la replaçant dans le cours de l’histoire elle perdait de son insolite. C’est alors que je me suis souvenue qu’un homme qui depuis tant d’années m’accompagnait par sa musique et faisait donc vraiment partie de ma vie, avait traversé une épidémie. J’ai commencé à me demander comment il avait vécu cette période ; et je me suis souvenue que c’était à cette période qu’il était devenu prêtre. J’ai cherché à observer à la loupe cet événement passé inaperçu, c’est-à-dire auquel les musicologues et biographes n’avaient attaché aucune importance ; j’ai tenté de reconstituer la chaîne causale qui avait pu le mener à prendre une telle décision ; j’ai essayé de refaire le chemin avec lui en remontant le cours du temps ; j’ai éprouvé le besoin de sonder un mystère, le silence qui avait sous-tendu cette décision – silence vaste, espace nu où la mûrir. Cet homme habité par les sons est allé puiser très profondément sa vérité dans le silence.
En dehors de la beauté de sa musique, ce que j’admire chez Monteverdi, c’est sa patience. Il n’a jamais cessé de chercher : sa création est expérimentale du début à la fin. Et rien ne l’a détourné de sa quête. Il a surmonté des drames, des deuils très douloureux et les pires difficultés matérielles. Il fait partie de ces créateurs, rares, dont le génie, au lieu de s’épuiser, s’est renouvelé, est allé croissant, à la fois toujours plus loin, plus profond, plus large et plus haut. Il a fait rendre à son esprit et à sa sensibilité tout ce qu’ils pouvaient donner, en développant toutes les virtualités de son être. Il a travaillé comme s’il devait vivre longtemps – et il a eu raison –, alors même qu’à son époque la vie était précaire. Il incarne donc un accomplissement exemplaire.
D’où vient l’originalité de votre écriture ?
J’ai essayé de différencier l’écriture de la partie contemporaine de celle qui relate le début des années 1630. Il y a un livre dans le livre, structure baroque bien connue. À l’intérieur des chapitres situés au XXIe siècle, j’ai inséré des chapitres qui commencent tous par une note de musique. Le premier mot de chacun d’entre eux commence donc par do, puis ré, mi, fa, sol, la, si, dans l’ordre de la gamme : c’est ainsi que sont introduits les passages concernant la vie du musicien. Dans ces passages, j’ai tenté aussi de me rapprocher le plus possible de la musique et de la poésie, notamment lorsque j’évoque l’eau, les canaux, la lagune. Tout le livre est sorti de la page qui a pris place p. 50 – c’est la première que j’ai écrite – et qui commence ainsi : « Docile était la rame qui fendait les eaux sombres. Il écoutait son rythme égal, la lente avancée de la barque dans l’immensité lagunaire. Elle glissait progressivement, traçant sa voie sur l’étendue de mercure liquide. Les pieux de bois émergeaient à peine de la brume. » Ce premier paragraphe et les suivants retracent l’arrivée du musicien, le 9 mars 1631, dans une église déserte, pour y recevoir les ordres mineurs. Ils m’ont été donnés – inspirés, si l’on veut – par l’ouverture du Retour d’Ulysse dans sa patrie. Un autre passage où j’ai tenté de faire entendre des sons et des rythmes en accord avec le lieu est le récit – là encore totalement inventé, car on en ignore les circonstances : on connaît seulement le fait – de la mort d’Alessandro Striggio, grand ami de Monteverdi, librettiste de l’Orfeo, ambassadeur de Mantoue qui introduisit à son insu la peste à Venise à la fin du printemps 1630.
C’est aussi un livre parlé, d’un bout à l’autre : un récit à la première personne, des dialogues, un récit à la troisième personne… Il fallait donner toute son importance à la voix, pour évoquer un musicien qui a fait porter une grande partie de ses recherches sur le « parlar cantando », littéralement le « parler en chantant ». La tessiture, la couleur de la voix faisant renaître la Venise frappée par la peste devaient être différentes de ce que le récit fait entendre des voix contemporaines, celle de la narratrice et de ses proches.
Quel message souhaiteriez-vous transmettre ?
Qu’une telle musique, capable de traduire la joie la plus céleste comme les passions les plus humaines, et pour laquelle la distinction entre sacré et profane n’a pas vraiment de sens, a un pouvoir immense, qui n’est pas seulement d’ordre esthétique. Elle répare, console, vivifie, sauve. Découverte par la narratrice en temps de pandémie, et à un moment où la distance s’installe entre elle et son mari, cette musique guérit aussi d’un mal encore plus insidieux qu’un virus qu’on a fini par identifier et rendre moins dangereux. Un mal auquel nous sommes exposés mais qui ne se donne pas pour tel, qui demeure masqué : une infection bien plus durable et destructrice, qui a d’ailleurs la même cause que l’autre : « l’horreur économique ». Une expression de Rimbaud (qui par la suite partit faire du commerce – mais c’est une autre histoire) reprise par Viviane Forrester pour le titre d’un essai resté célèbre. Elle prend tout son sens avec la mondialisation : faire toujours plus de profit, et pour cela baisser les coûts de production, quitte à prendre des risques sanitaires ou à exploiter des êtres ; produire à l’échelle planétaire des produits de qualité douteuse, en les imposant à grands coups de publicité à des consommateurs endoctrinés, privés d’esprit critique, qui sont ravis de manger la même nourriture industrielle, d’entendre et de répéter les mêmes mots appauvris, de regarder, hypnotisés, les mêmes images vendues à toutes les chaînes de tous les pays supposés civilisés. La narratrice pense à tout cela, en se demandant si elle parviendra à trouver un équilibre pour ses enfants : faire en sorte qu’ils restent insérés dans la société, ce qui implique d’être les victimes inconscientes et consentantes de la situation que je viens de résumer ; mais aussi espérer qu’ils parviennent à être immunisés. L’art – un sujet récurrent dans mes livres – permet de mettre ce danger à distance, pourvu qu’il ne devienne pas lui-même un objet de spéculation.