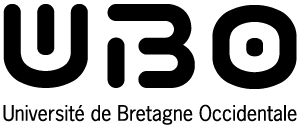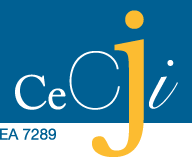Nicolas Dufourcq, Journal des moments Garache, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2025, 152 p. ISBN : 978-2-85035-172-3 25 € |
Claude Garache face au réel
Les « repères biographiques » mis à la disposition des visiteurs de l’exposition « Dans l’amitié de Claude Garache », qui eut lieu à la Maison Zervos de Vézelay à l’été 2023, mentionnaient, à propos de l’année 1948 : « Achète ses premiers livres de poésie contemporaine à la librairie La Hune, en particulier ceux des éditions G.L.M ». L’attirance et la reconnaissance furent mutuelles car les plus grands poètes de sa génération, Yves Bonnefoy le premier, mais aussi Philippe Jaccottet et Jacques Dupin, furent les exégètes de son œuvre, en prose (Bonnefoy) et en vers (Dupin, Jaccottet). Garache réalisa aussi des livres en collaboration avec Bonnefoy (L’Ordalie, Maeght, 1975; il devait y avoir auparavant, au milieu des années 60, une édition illustrée d'un récit, L'Écharpe rouge, qui ne vit le jour, finalement sans gravures, qu'en 2016), Edmond Jabès (Désir d’un commencement, angoisse d’une seule fin, Fata Morgana, 1991), Jaccottet (Année, Conférence, 2006) ; et, pour les poètes de la génération suivante Alain Veinstein (Ébauche du féminin, Maeght, 1981), Philippe Denis (Notes lentes, La Dogana, 1996), Yves Peyré (Prière pour les autres jours, 1997), Florian Rodari (À voix nues, Conférence, 2010), Pierre-Alain Tâche (Une réponse sans fin tentée, L’Atelier contemporain, 2015), Esther Tellermann (Corps rassemblé, Éditions Unes, 2020). Il réalisa aussi deux livres en collaboration avec Jean Starobinski (qui, de son côté, lui consacra plusieurs études), dont un en hommage à André Chénier (La Caresse et le fouet, Éditart, 1999) et illustra la traduction de L’autre vérité. Journal d’une étrangère d’Alda Merini (Conférence, 2010).
C’est précisément la forme diaristique que Nicolas Dufourcq a choisie pour lui rendre hommage. Forme inédite, dans l’abondante littérature sur l’œuvre du peintre, et d’autant plus intéressante par sa nouveauté. Pendant près de six ans, d’octobre 2017 au mois d’août 2023, Nicolas Dufourcq a tenu un journal de ses entrevues avec Claude Garache, de la naissance et de l’affirmation de leur amitié. Il achetait des eaux-fortes de l’artiste à la librairie Tschann mais n’osait pas le rencontrer : « Elles dégageaient une telle intensité de silence habité que j’hésitais à déranger celui qui en était le créateur. Je l’imaginais enveloppé d’un même silence »[1]. Cette intuition s’est vérifiée, même si celui qui l’accueillit, quand Nicolas Dufourcq se décida à franchir le seuil de l’atelier, s’avéra affable et courtois : « Il me présente ses tableaux en silence. Je suis moi-même presque muet. Il y a dans l’atelier de la rue du Cherche-Midi aux murs ocre un silence si puissant qu’on pourrait l’entendre. »[2]
Ce journal est écrit au présent. Le temps grammatical semble ainsi coïncider avec le temps réel, et le lecteur suit la découverte progressive, par celui qui la relate, d’un artiste et de ses toiles, mais aussi de la vie quotidienne menée dans un périmètre à la fois étroit et suffisant (de la rue Notre-Dame des Champs à la rue du Cherche-Midi) : si Garache a voyagé dans les années 50, il est « absolument sédentaire »[3], remarque son visiteur. Chaque récit d’un « moment » poursuit l’expérience du regard porté à la fois sur l’artiste et sur ses toiles. Au fil des rencontres et des entretiens retranscrits s’ébauche puis se précise un portrait du peintre.
Celles et ceux qui, admirant l’œuvre de Claude Garache, ont eu la chance de le rencontrer, ne pouvaient qu’être saisis par la qualité particulière de sa présence. Claude Garache était un homme rare. Élégant, simple et vrai. Il ne jouait aucun rôle. Son rayonnement intérieur, immédiatement perceptible, évident au sens premier du terme, ne procédait d’aucun désir de paraître, d’impressionner ; il provenait d’un juste équilibre entre le dedans et le dehors. On devinait chez cet homme attentif aux autres et généreux d’insondables mais non inquiétantes réserves de silence, de recueillement, de patience, de réflexion[4] ; une tension vers un but poursuivi, pour reprendre l’expression d’Yves Bonnefoy, avec une « certitude secrète »[5].
Illustré de nombreuses photos (de tableaux, du peintre lui-même, seul ou avec sa femme Hélène, de son atelier, de moments d’amitié avec l’auteur, sa femme, l’un de ses fils, de marées en Bretagne…), le journal tenu par Nicolas Dufourcq sauvegarde une matière vivante, palpitante, capte un regard, un geste, un sourire, une vibration, et restitue souvent la voix du peintre. La « bonne question » à se poser, dit celui-ci, est « que faire de ce que je vois, qui est là devant moi, que faire du réel, qui enveloppe et me dicte ma vie et mes mouvements ? »[6]. Le réel est une énigme qu’il faut creuser sans relâche. « Je cherche une présence absolue de moi-même et un accès à la présence absolue du corps devant moi, que je reçois comme une immensité, une bénédiction ». L’acte de peindre permet de se rapprocher « autant que possible de cette beauté qui vous submerge »[7]. Il livre aussi ce refus essentiel : « Je refuse qu’on me photographie dans l’acte de peindre. Ce serait d’une grande impudeur, une attaque violente contre l’intime »[8]. La pudeur lui était consubstantielle, et se vérifie dans la peinture à laquelle il vouait sa vie. Yves Bonnefoy, Jacques Thuillier, Roger Munier, Jean Starobinski, Michaël Edwards, Nicolas Pesquès, Pierre-Alain Tâche ont tous remarqué que ses nus rouges n’étaient pas érotiques. Ils ont interprété sa peinture comme une « pratique spirituelle », un « exercice spirituel », une « prière silencieuse », en dehors de toute éducation religieuse et de toute foi. Michaël Edwards, dans une étude admirable, a décelé dans le geste répétitif du peintre, « l’attente toujours renouvelée, dans un lieu qui ne change pas, du miracle à venir »[9]. L’ascèse de Garache (qui, rappelle Nicolas Dufourcq, travaillait quatre heures tous les matins, sept jours sur sept[10]) s’accordait avec la nudité des modèles, le dépouillement de son atelier, l’ordre de ses tubes alignés sur le sol, la rigueur avec laquelle il nettoyait ses pinceaux et veillait à la fixation des tableaux qui avaient quitté l’atelier. À son tour, Nicolas Dufourcq, dans les notes finales qui suivent la mort du peintre, évoque « la quête mystique de Claude »[11]. Celui-ci « a cherché durant toute son existence à représenter la vibration de la vie et de la lumière à travers le corps féminin, peint d’une seule couleur pendant soixante ans, le rouge cadmium. […] Chaque séance était une épiphanie, où naissait pour lui la possibilité d’atteindre le mystère de l’espace et de la vie sur terre au travers de la présence vibratoire d’un corps de femme. »[12]
Au fil des rencontres, le peintre évoque ses amis poètes, quelques projets de collaboration qui n’eurent pas de suite[13], ses lectures[14], son admiration pour la « splendide structure de pensée »[15] de Jean Starobinski ; la reconnaissance de l’influence de Degas, son admiration pour Cézanne et Matisse, son rejet de la spéculation sur l’art, son regret de la fin des correspondances et de l’archive. Sa reconnaissance a peu dépassé le cercle des happy few : « Aucune amertume chez Claude, toujours cette liberté souriante »[16]. Ce journal nous apprend que le peintre retravaillait ses toiles, parfois longtemps après[17] ; qu’il a tenu à préserver son indépendance (« Je suis un électron libre »[18]) ; que ses modèles ont souvent été des Polonaises qui venaient d’arriver en France. Il livre aussi quelques informations familiales inédites : la perte très prématurée du père, celle de sa mère lorsqu’il avait vingt ans, l’admiration pour un frère résistant. Et il donne toute sa place à Hélène, rencontrée en 1948 chez le sculpteur Robert Coutin, épousée neuf ans plus tard. Elle aussi a poursuivi sa quête jusqu’au bout, ne cessant de créer sans jamais exposer. Quand le Musée d’art moderne de Paris lui propose de choisir quelques-unes de ses œuvres, il est très tard : elle a quatre-vingt-quatorze ans et ne verra pas l’exposition, s’éteignant au lendemain du vernissage, le 16 avril 2023, aux côtés de celui dont elle avait partagé la vie pendant soixante-quatorze ans, et qui ne tarda pas à la rejoindre, le 29 août. Les photos de ses sculptures inspirées par la nature amènent à penser que les noms donnés par Garache à ses tableaux depuis les années 60, encore plus mystérieux que ceux que François Couperin attribuait à ses pièces de clavecin méthodiquement classées en « ordres », trouvent peut-être, pour beaucoup d’entre eux[19], leur source secrète dans les sculptures de sa femme : car Couze, Bresque, Méouge, Loing, Yvie sont des cours d’eaux, Avocette est un oiseau, Nonée une fleur, Gesse, Épiaire, des plantes, Beille, Bessillon, des massifs montagneux… Ces sculptures d’arbres, de cascades, de montagnes, laissent aussi penser que cette œuvre était en fait venue trop tôt. On peut donc reprendre à son égard ce que Jacques Thuillier écrivait en 1975 à propos de celle de son mari : « Dans trente ans l’on pourra savoir si Garache était le précurseur d’une nouvelle peinture. Ou dans quinze ou dans cinquante. »[20] Nous voici cinquante ans plus tard. Le Journal des moments Garache s’achève sur l’image de « deux artistes absolus se tenant debout ensemble devant l’abîme des questions »[21].
Sophie Guermès
[1] Nicolas Dufourcq, Journal des moments Garache, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2025, p. 7.
[2] Ibid., p. 9. C’est encore le silence qui est évoqué, à la fin du livre : « Ce qui le distingue est le silence qui entoure ses figures. […] Le dessin de Garache est baroque, mais la sonorité qu’il dégage ne l’est pas. Il est le silence. » (ibid., p. 137).
[3] Ibid., p. 39.
[4] Ce qu’Anne de Staël traduisit à sa façon, dans un texte, « Yvie et Sauve », dont elle donna lecture à la librairie Tschann, le 8 juin 2006, à l’occasion de la sortie du livre collectif Garache face au modèle (Chêne-Bourg, La Dogana, 2006) : « le peintre que je rencontrais pour la première fois m’avait laissé une impression de ‘vieux Chinois’. Vieux Chinois résonnait pour moi au son de ces poèmes d’une très lointaine dynastie que j’avais habités toute mon adolescence ; poèmes qui savaient garder le silence absolu et mieux que silence, l’apnée d’une profondeur où la respiration se tient sur le couperet. » (ibid., p. 91). Voir dans le même volume l’étude de Michaël Edwards, « L’infini du corps » : « on devine une sagesse étrangère à la nôtre, celle sans doute qui décida certains peintres chinois à ne connaître que la montagne et le lac, ou le pin et le bambou » (ibid., p. 115).
[5] Yves Bonnefoy, « Dans la couleur de Garache », Catalogue de l’exposition Garache à la Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence, du 9 février au 10 mars 1974 (cet essai a été repris dans Le Nuage rouge, Paris, Mercure de France, 1977, pp. 331-336, puis dans Garache face au modèle, op. cit., pp. 13-29, ici p. 28).
[6] Nicolas Dufourcq, op. cit., p. 45.
[7] Ibid., p. 13 pour les deux citations.
[8] Ibid., p. 39.
[9] Michaël Edwards, « L’infini du corps », Garache face au modèle, op. cit., p. 119.
[10] Nicolas Dufourcq, op. cit., p. 57.
[11] Ibid., p. 137.
[12] Ibid., p. 135.
[13] Notamment un projet avec Claude Simon. Cela n’empêcha pas Claude Garache de rester proche du romancier qui avait d’abord voulu être peintre. Je me souviens de la séance de dédicace du Jardin des Plantes à la librairie Compagnie, en septembre 1997 : Claude Simon assis devant une table, signant ses livres, Jérôme Lindon debout derrière lui, Claude Garache aux côtés de l’écrivain.
[14] « Vous savez, mon rapport à la littérature est essentiel » fut la dernière phrase transcrite du dernier entretien qu’il accorda, le 17 juillet 2023 (Céline Chicha-Castex, Marie Minssieux-Chamonard et Amaury Nauroy, « Entretien avec Claude Garache », Nouvelles de l’estampe, 271 | 2024, mis en ligne le 15 avril 2024, consulté le 22 février 2025. URL :
[15] Nicolas Dufourcq, op. cit., p. 89.
[16] Ibid., p. 119.
[17] Cf. ibid., p. 14, 74, 93.
[18] Ibid., p. 71. Jean Starobinski le voyait « « irréductible à toute complaisance » (Garache, Paris, Flammarion/ Galerie Lelong, 1988, p. 7).
[19] D’autres (Appe, Auche, Epiairoue, Arguine…) sont inventés – preuve, une fois encore, du rapport consubstantiel de Claude Garache à la poésie.
[20] Jacques Thuillier, « Notes brèves sur Claude Garache », Derrière le miroir, n° 213, Paris, Maeght, 1975, p. 24.
[21] Nicolas Dufourcq, op. cit., p. 137.